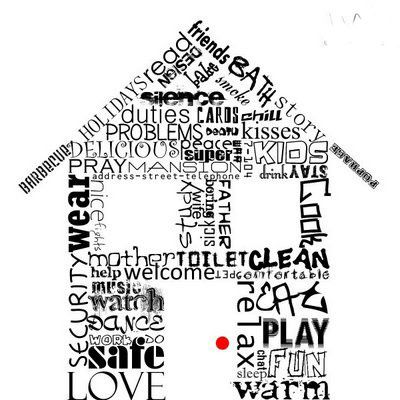La langue française est caractérisée par sa richesse mais aussi par sa complexité. J’analyse dans cet article 30 difficultés du français que j’ai rencontrées, avec à chaque fois les règles correspondantes afin de les surmonter. Je me suis notamment inspiré des excellents conseils de l’Académie française, de ceux du projet Voltaire ainsi que du forum de languefrancaise.net.
Je vous engage à parcourir le sommaire pour voir les difficultés que vous avez déjà rencontrées. N’hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d’autres cas que j’aurais omis.
1#« la voiture de Julie » ou « la voiture à Julie » ?
à : La préposition « à » marque l’appartenance. Elle s’utilise :
après un verbe (« Cette voiture est à Papa »).
devant un pronom (« un ami à nous », « sa façon à elle »)
de : On utilise « de » lorsqu’il est placé entre deux noms (« la voiture de Julie », « la moto de la police »).
Exceptions : fils à papa, bête à bon dieu, barbe à papa…
2# À l’attention de, à l’intention de
À l’attention de : on l’utilise dans le langage de l’administration pour indiquer le destinataire d’une lettre, d’une note administrative, d’un envoi etc. Cela se fait à l’attention de, pour marquer que l’on attire l’attention du destinataire, que l’on soumet quelque chose à son attention.
À l’intention de (quelqu’un) : signifie « pour lui, dans le but que cela lui soit agréable, profitable, bénéfique ». Exemples : Il a acheté ce livre à leur intention, dans le but de leur offrir. On écrit une chanson à l’intention de son ami.
3# À ou chez (établissements commerciaux)
Chez ne s’utilise qu’en parlant de personnes et, par extension, d’êtres animés ou d’êtres personnifiés. Exemples : Il habite chez ses parents. Chez les aigles, le bec est jaune.
Dans le cas d’établissements commerciaux, quatre cas sont possibles :
– le nom de l’établissement se confond avec un nom de personne : on utilise chez. Exemple : Aller chez Durand et fils.
– le nom de l’établissement est un nom de chose ou un groupe comprenant un nom de chose, et l’on utilise à. Exemple : Aller au Bon Marché.
– on traite comme nom de chose ce qui était autrefois un nom de personne et on utilise à. Exemple : Aller à la Samaritaine.
– on traite comme nom de personne un nom de chose, un acronyme, etc. et on utilise chez. Exemple : Aller chez Fiat.
Attention, dans le cas où l’usage n’est pas fixé, à ou chez sont possibles : certains auront en tête le nom de personne Leclerc et diront chez Leclerc ; d’autres, par une sorte d’ellipse, diront à Leclerc pour au magasin Leclerc. On n’utilisera « à » que pour désigner un magasin particulier : à l’Auchan de tel endroit, au Carrefour de telle ville.
4# Adjectif ou nom de nationalité : « il est français » ou « il est Français » ?
Pour les noms et adjectifs, la majuscule est utilisée dans le cas où on désigne une personne habitant dans un pays ou en étant originaire. Exemple : Un Français mais un fromage français.
Pour désigner la langue on n’utilise jamais de majuscule. Exemple : Je veux apprendre le français.
Astuce : ces règles valent aussi pour les régions : un Parisien, une Normande, un Asiatique mais un monument parisien, le parler normand, la cuisine asiatique.
Dans la phrase Il est français, si on considère que « français » est un adjectif alors on utilise la minuscule (solution préférée par l’Académie française), si on le considère comme un attribut on utilise la majuscule.
5# Adjectif verbal ou participe présent : « fatigant » ou « fatiguant » ?
Pour ne pas se tromper, il suffit de remplacer fatigant/fatiguant par un autre adjectif : si c’est possible, on écrit fatigant sans u, sinon c’est le participe présent qui garde le radical du verbe (avec u) : fatiguant.
Exemples :
-C’est fatigant de faire du sport (= c’est difficile de faire du sport → adjectif → pas de u intercalaire).
–C’est en se fatiguant au travail qu’il est tombé malade (participe présent → u intercalaire).
-C’est un travail fatigant (adjectif) mais C’est un travail fatiguant le dos (participe présent).
Astuce : on utilise la même règle pour extravaguant / extravagant, fringuant / fringant, naviguant / navigant.
6# An, année
An désigne une période indivisible, une simple unité de temps, abstraction faite des divisions que l’on pratique dans l’année. On l’emploie le plus souvent avec un adjectif numéral, indiquer un âge ou situer un moment dans une époque.
Exemples : Depuis vingt ans. Il a dix ans. L’an 2000.
Année, qui est presque toujours qualifié par un adjectif, est la période annuelle considérée dans la durée.
Exemples : année civile, bissextile ; l’année dernière ; à la fin de l’année ; l’année de sa naissance.
7# « Les danseuses étoiles regardent des films culte »
Au pluriel, lorsque deux noms sont apposés, le deuxième nom varie uniquement si on peut établir une relation d’équivalence entre celui-ci et le premier.
Ainsi, on écrira Les danseuses étoiles regardent des films culte, car si l’on considère que les danseuses sont des étoiles (elles ont les mêmes propriétés qu’elles, elles brillent de la même façon), il est évident que les films ne sont pas des cultes, mais qu’ils font l’objet d’un culte.
8# « Autant pour moi » ou « Au temps pour moi » ?
« Au temps pour moi » est une locution exprimant la reconnaissance d’une erreur de la part du locuteur. On rencontre couramment la graphie « Autant pour moi », qui est incorrecte selon l’Académie française, mais qui est défendue par certains hommes de lettres et certains grammairiens.
À l’origine, « au temps » est une expression militaire signifiant qu’un des soldats n’était pas dans le temps en faisant un mouvement, et que l’opération devait être reprise depuis le début.
9# « Elle a l’air malin » ou « Elle a l’air maligne » ?
Lorsqu’on peut remplacer le verbe avoir par « prendre » alors on n’accorde pas avec le sujet.
Exemple : avoir l’air noble, l’air guerrier, l’air martial ; Elle a l’air gracieux ; Elles ont l’air niais de leur tante.
Dans les autres cas, « l’air » prend le sens de « sembler, paraître » et l’adjectif qui suit s’accorde avec le sujet.
Exemple : Elle a l’air méfiante ; Ils ont l’air imbus de leur personne ; Ces prunes ont l’air bonnes, mauvaises ; Cette maison a l’air abandonnée ; Elle a l’air maligne.
10# Ce qui reste ou ce qu’il reste ?
Avec les verbes susceptibles d’être construits soit personnellement, soit impersonnellement, on utilise ce qui ou ce qu’il : qui est le sujet du verbe construit personnellement, qu’il apparaît dans la tournure impersonnelle.
Cependant, il est parfois impossible de faire la nuance. Ainsi on peut dire : nous verrons ce qui se passera ou ce qu’il se passera.
11# Jeudi et vendredi « prochain » ou « prochains » ?
L’adjectif s’accorde en genre et en nombre.
Exemples : jeudi prochain ; jeudi et vendredi prochains ; les deux semaines d’avril prochaines.
12# Courbatu, courbaturé
Le Dictionnaire de l’Académie française (neuvième édition, en cours de publication), donne les définitions suivantes :
COURBATU,-UE adj. XIVe siècle. Déformation de court-battu, composé de court, pris adverbialement, et de battu, proprement « battu à bras raccourcis », « bien battu ».
Qui éprouve une grande lassitude du corps et surtout des jambes. Après cette longue marche, je me sentais tout courbatu.
COURBATURE n. f. XVIe siècle. Dérivé de courbatu. Raideur musculaire provoquée par la fatigue ou la maladie. Avoir des courbatures.
COURBATURER v. tr. XIXe siècle. Dérivé de courbature.
13# Deuxième, second
En pratique, on utilise deuxième lorsque la série comprend plus de deux éléments. Si la série s’arrête à deux éléments, on utilisera second.
Exemple : Il est arrivé deuxième alors qu’il y avait 500 participants. (il y a plus de deux participants). Il est arrivé second (il n’y a que deux participants à la course).
14# En termes de / au terme de
Règle 1 : Dans le sens de « dans le vocabulaire, dans le langage de », en termes de est la seule forme correcte : en termes de marine, de médecine, de jurisprudence, etc.
Règle 2 : En termes de au sens de « en matière de » est un anglicisme à proscrire. On emploiera donc les locutions quant à, en matière de ou en ce qui concerne.
Règle 3 : Au terme de, quant à lui, signifie « à la fin de » : Au terme de l’année de première, les lycéens passent le baccalauréat de français.
15# Le haricot ou l’haricot ?
Le h de haricot est « aspiré », c’est-à-dire qu’il interdit la liaison, impose que ce mot soit prononcé disjoint de celui qui le précède, au singulier comme au pluriel.
Exemple : on écrit et dit : le haricot, non l’haricot ; un beau haricot, non un bel haricot.
Astuce : tous les dictionnaires indiquent par un signe conventionnel quels h (généralement d’origine germanique) sont aspirés et quels h (généralement d’origine gréco-latine) ne le sont pas. Pour certains mots, l’usage est indécis. Ce n’est pas le cas de haricot : faire la liaison est une faute.
16# « Le plus belle » ou « la plus belle »
Lorsqu’on peut remplacer par « au plus haut degré » alors l’article reste invariable (lorsqu’une chose n’est comparée qu’à elle-même).
Exemple : C’est le matin que la rose est le plus belle (c’est le matin qu’elle est belle au plus haut degré).
Cependant, l’article varie si la comparaison s’effectue entre deux entités différentes.
Exemples : Cette rose est la plus belle de toutes ; Cette rose est la moins fanée (sous-entendu : « des roses », « des fleurs »).
17# Tant pis, tampis
Nous confondons de plus en plus tant pis avec tampis. L’orthographe tampis est bien sûr incorrecte et il faut écrire tant pis qui signifie « c’est dommage, c’est ennuyeux, c’est préjudiciable mais c’est ainsi ».
18# Quoique, quoi que
Quoique, en un seul mot, est utilisé si on peut le remplacer par bien que ou encore que.
Exemples : Nous lui avons conservé notre amitié, quoiqu’il ait menti. Quoiqu’il relève de maladie, il a tenu à être présent. Quoique ne manquant pas d’aisance, il prenait rarement la parole (Bien que ne manquant pas d’aisance…
Quoi que, en deux mots, est utilisé si on peut le remplacer par peu importe ce que.
Exemples : Quoi que je dise, personne ne me croit (Peu importe ce que je dis, personne ne me croit). Quoi que vous fassiez, il faut réussir.
19# Tel, tel que / Telle, telle que
Règle 1 : tel que s’accorde avec le nom qui le précède et dont il dépend
Exemple : les bêtes féroces telles que le tigre, le lion, etc. ;
Règle 2 : tel sans que s’accorde avec le terme qui suit. L’Académie française signale toutefois que certains grands auteurs, tel Georges Duhamel, ont employé tel accordé avec le terme qui le précède.
Exemple : L’homme en colère, telle une bête féroce…
Règle 3 : comme tel et en tant que tel s’accordent avec le terme auquel on compare le sujet.
Exemple : des fruits considérés comme des légumes et cuisinés comme tels (comme des légumes) ;
Règle 4 : tel quel s’accorde avec le nom auquel il se rapporte.
Exemple : Je vous rends votre somme d’argent telle quelle ; Je cite vos propos tels quels.
20# Travail, travaux, travails
Règle 1 : Le pluriel du nom travail est la forme travaux (travails ne s’emploie que si l’on parle du dispositif servant à maintenir les grands animaux domestiques pour les ferrer ou les soigner).
Exemples : travaux d’embellissement, de rénovation ; travaux de couture ; les travaux de l’Assemblée, du Sénat ; les travaux d’Hercule, etc.
Règle 2 : Lorsque l’on emploie le terme travail au sens général d’activité professionnelle, il est d’usage de ne pas l’utiliser au pluriel.
Exemple : j’ai un travail mais plutôt j’ai deux emplois, deux professions (pas j’ai deux travaux).
21# « les mêmes penchants que moi » ou « … que les miens » ?
Je reprends ici l’excellente réponse d’Abel Boyer :
« Je lui soupçonne les mêmes penchants que les miens pour le tennis et la lecture… »
Phrase correcte grammaticalement. Les penchants, les siens et les miens, sont mis en parallèle, tous deux en COD.
« Je lui soupçonne les mêmes penchants que moi pour le tennis et la lecture… »
Phrase incorrecte formellement, quoique acceptable par ellipse. Ici, on met en parallèle les penchants « à lui » et les penchants « à moi », tous deux COI. Il faudrait donc :
« Je lui soupçonne les mêmes penchants qu‘à moi pour le tennis et la lecture… »
En revanche, on pourrait dire bien sûr :
Il a les mêmes penchants que moi pour le tennis et la lecture.
où il et moi sont mis en parallèle en tant que sujets.
22# « à petit feu » ou « à petits feux » ?
Règle 1 : on utilise à petit feu sans -x pour exprimer la lenteur et la durée de l’action.
Exemple : je fais rôtir la viande à petit feu (idée que ça prend du temps et que ça dure).
Règle 2 : on utilise seulement feux avec un -x dans certains cas comme « briller de mille feux« , lorsqu’on parle de plusieurs feux (pluriel).
Exemples : entre deux feux, les feux de position.
23# L’usage de demi-
Règle 1 : Placé devant un nom ou un adjectif, « demi » est invariable :
Exemples : une demi-heure, des demi-frères, des petits pois demi-fins
Règle 2 : Placé derrière un nom ou un adjectif, « demi » peut prendre la marque du féminin, mais jamais celle du pluriel :
Exemples : deux heures et demie, trois mois et demi
Règle 3 : La locution « à demi », qu’on trouve dans « à demi-mot » ou « à demi nu », est invariable mais n’est pas suivie d’un trait d’union devant un adjectif.
Exemples : la fenêtre à demi fermée.
Règle 4 : « demi » peut aussi être un nom
Exemple : Ils ont bu quatre demis de bière.
24# Ci-annexé, ci-inclus, ci-joint
Règle 1 : on accorde quand ces expressions suivent directement le nom ou lorsqu’elles sont attributs du sujet (Les lettres sont ci-jointes).
Exemples : La lettre ci-annexée ; La note ci-incluse apporte les précisions nécessaires ; Veuillez remplir la déclaration ci-jointe.
Règle 2 : On n’accorde pas lorsque ces expressions ont une valeur adverbiale, et notamment :
– lorsqu’elles sont placées en tête d’une phrase sans verbe, devant un groupe nominal.
Exemples : Ci-annexé la copie des pièces demandées. Ci-inclus les photocopies du document ; Ci-joint l’expédition du jugement ; Ci-joint les deux quittances exigées.
– à l’intérieur d’une phrase, avec un nom sans déterminant.
Exemples : Je vous adresse ci-inclus quittance de votre versement ; Vous trouverez ci-joint copie du contrat ; La circulaire dont vous trouverez copie ci-inclus.
Règle 3 : Dans les autres cas l’usage n’est pas fixé.
Exemples : Je vous fais parvenir ci-joint, ou ci-joints plusieurs exemplaires de mon mémoire. Si Bernanos écrit à l’un de ses correspondants : « Vous trouverez ci-joint les pages dactylographiées de mon roman », Hugo préfère : « Je vous envoie ci-incluses des paroles prononcées ici par moi au moment de la proscription ».
25# Accord avec « gens »
Règle 1 : Gens immédiatement précédé d’un adjectif est au féminin.
Exemples : de vieilles gens, de bonnes gens.
Règle 2 : Lorsque l’adjectif qui précède gens en est séparé par une virgule, il est au masculin.
Exemples : confiants et naïfs, les gens le croient.
Règle 3 : Lorsque l’adjectif suit gens, il est au masculin.
Exemples : des gens bruyants ; des gens intelligents.
Règle 4 : Gens de… L’adjectif est toujours au masculin avec les expressions gens de robe, gens d’Église, gens d’épée, gens de guerre, gens de lettres, gens de loi.
Règle 5 : « Jeunes gens » est toujours au masculin. Il en va de même pour l’usage de gens au sens de « domestiques » ou de « partisans » (nos gens sont sûrs et dévoués).
26# les toilettes « handicapés » ou « handicapées »
Handicapé est ici un substantif, c’est-à-dire une unité lexicale qui désigne une chose par elle-même. Handicapé n’est donc pas à prendre comme un adjectif. Le nom placé en apposition ne s’accorde pas.
On écrira : toilettes handicapés comme toilettes hommes / toilettes femmes ou toilette handicapé.
27# Vive les vacances ou vivent les vacances ?
Option 1 : si on considère que la phrase exprime un souhait, le verbe s’accordera naturellement avec son sujet et l’on pourra écrire Vivent les vacances.
Option 2 : vive est aujourd’hui perçu plus souvent comme un simple mot exclamatif que comme un verbe traduisant un véritable souhait de longue existence, ce qui explique que ce terme tende à perdre sa valeur verbale et qu’on puisse le considérer comme une particule à valeur prépositionnelle : on le rencontre par conséquent fréquemment au singulier et on écrire Vive les vacances !
28# Leur chapeau ou leurs chapeaux ?
Il n’y a pas véritablement de règle pour ce cas et les plus grands auteurs hésitent entre l’usage du singulier ou du pluriel selon qu’il y a plusieurs personnes qui possèdent chacune un chapeau.
Exemples : « Mes compagnons, ôtant leur chapeau goudronné […] » (Chateaubriand) ; « Les deux lords […] ôtèrent leurs chapeaux » (Hugo) ; « trois avaient déjà retrouvé leur femme » (Chamson) ; « deux de mes amis et leurs femmes » (Arland).
29# Biensur, bien sûr
Si « bien sûr » a le même sens que « évidemment », il ne faut surtout pas l’écrire comme ce dernier en un seul mot ! Bien sûr s’écrit toujours en deux mots.
30# tache, tâche
Règle 1 : Si vous pouvez remplacer le mot par « corvée », « travail », « besogne » ou « fonction », écrivez tâche, l’accent circonflexe pesant sur le « a » comme le fardeau du travail sur vos épaules.
Exemples : Je baisse les bras devant l’ampleur de la tâche (Je baisse les bras devant l’ampleur du travail). Les tâches effectuées par le stagiaire sont simples (Les corvées effectuées par le stagiaire sont simples).
Règle 2 : Si vous pouvez remplacer le mot par « salissure », « souillure », « marque » ou « faute », écrivez tache.
Exemples : Sa réputation est sans tache (Sa réputation est sans souillure). Même les pires taches ne résistent pas à ce nettoyant (Même les pires salissures ne résistent pas à ce nettoyant).